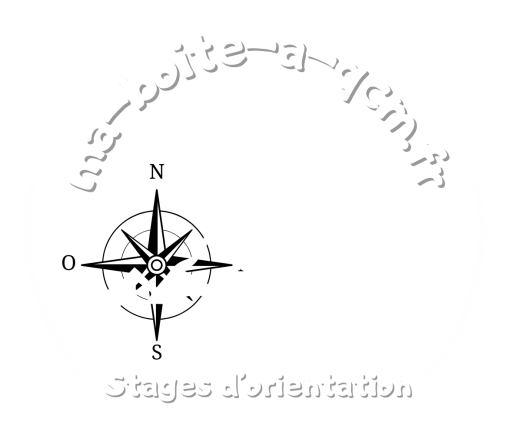Origine géologique des massifs français
Avant de parler de l’histoire « récente » des massifs français, un petit retour à l’ère Primaire.
Il y a environ 300 millions d’années, la collision des 2 continents principaux existants à l’époque, le Gondwana et la Laurussia a donné naissance à un continent unique la Pangée. Cette collision a formé une vaste chaine de montagne barrant ce nouveau continent d’Est en Ouest. Cette chaine, qui s’appelait la chaine hercynienne ou varisque (plissement hercynien/varisque), s’étendait, entre autre, sur une grande partie de ce qui est aujourd’hui la France et le territoire européen. Une grande quantité de roches magmatiques plutoniques (cristallines, des granitoïdes) et métamorphiques s’est trouvée engagée dans cette orogenèse et a formé de gigantesques montagnes. Ces montagnes ont été arasées durant les dizaines de millions d’années qui ont suivi, pour laisser une pénéplaine (espace peu valloné) de roches cristallines et métamorphiques qui seront reprises par les orogenèses suivantes (alpine, pyrénéenne). C’est le socle cristallin des plaques continentales. Ce dernier sera ensuite recouvert de roches sédimentaires ou volcaniques à la faveur de transgressions marines (lorsque la mer recouvre la plaque continentale) ou de périodes de volcanisme.
Voyons maintenant quelques éléments de l’origine géologiques de la formation des différents massifs.
Les différents massifs
Alpes
L’histoire des Alpes se scindent en deux étapes : une phase extensive et une phase compressive. Si la phase compressive permet de dater l’orogenèse alpine à l’ère Tertiaire (-35 à -25 millions d’années), beaucoup de roches qui se retrouvent sur les sommets alpins ont été formées bien antérieurement.
La phase extensive : Au début du secondaire, la Pangée commence à se fractionner. Des océans s’ouvrent. Au niveau de nos régions actuelles, un premier océan s’ouvre, la Thétys alpine ou océan liguro-piemontais, entre ce qui aujourd’hui est l’Italie et le Briançonnais. Puis un deuxième, l’océan Valaisan, entre le Dauphiné et le Briançonnais. Qui dit ouverture d’un océan, dit dorsale/rift avec remontée de lave au niveau de celle-ci et création de plaque océanique. Puis sédimentation au fond de ces océans.
La phase compressive : vers -100 millions d’années, la phase extensive stoppe. La plaque africaine subit un mouvement de rotation et se rapproche de la plaque européenne. Cette dernière va commencer à s’enfoncer sous l’Apulie, partie de la plaque africaine, et former une zone de subduction (enfoncement d’une plaque sous l’autre) au niveau de l’océan liguro-piemontais, sur sa marge orientale.
Au fur et à mesure de l’évolution de la subduction, la Téthys alpine se referme. Des parties entières de la marge européenne, du microcontinent briançonnais et de plancher océanique vont ainsi disparaître dans la fosse de subduction, jusqu’à des profondeurs d’enfouissement de 50 à 100 kilomètres. Les roches ainsi subductées vont subir un processus de métamorphisme de haute pression qui va totalement les transformer. Les schistes lustrés sont un exemple de résultat du processus métamorphique. D’autres séries géologiques vont au contraire être préservées et vont s’accréter sous forme de prisme, sans entrer en subduction. On parle alors de processus d’obduction, grâce auquel les ophiolites, pillow laves, par exemple, sont actuellement observables.
Les ophiolites sont des « roches vertes » qui forment le plancher océanique et sont charriées sur le continent lors d’une collision de plaques.
La Thétys alpine est totalement refermée à -30 millions d’années et les plaques continentales européenne et africaine rentrent en contact. C’est la collision de ces deux plaques qui marque le début de la formation des Alpes stricto-sensu. La rencontre des deux masses continentales va ainsi engendrer une importante déformation des unités sédimentaires et cristallines (les roches du socle continental) : phénomènes de charriage de nappes, intenses plissements et chevauchements.
Petit à petit, la déformation se propage vers les parties les plus externes du massif en cours de formation, menant au soulèvement d’une série de hauts sommets (mont Blanc, Belledonne…). Cet épisode compressif se poursuit au Miocène supérieur (-12 Ma) par la formation des chaînes d’avant-pays que sont le Jura et la nappe de Digne. Plusieurs phases de déformation compressive seront ainsi nécessaires avant d’obtenir l’architecture complexe des Alpes actuelles.
https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/alpes-sont-formees-alpes-16171/
Pyrénées
Tout comme pour les Alpes, la formation des Pyrénées commence par une phase d’extension.
Le bloc ibérique (l’actuelle Espagne), n’est alors pas du tout dans sa position actuelle. Il est rattaché à la marge ouest européenne, l’actuelle côte atlantique française. Le golfe de Gascogne n’existe alors pas encore. La tectonique extensive, associée au début du cycle alpin, va entrainer la formation de plusieurs bassins intracontinentaux au cours du Secondaire.
L’ouverture de l’Atlantique central a pour conséquence le déplacement de la plaque ibérique vers le sud-ouest.
La plaque ibérique effectue ainsi un mouvement de rotation anti-horaire avant d’entamer un déplacement latéral vers l’est de 200km se rapprochant de sa position actuelle. Cette phase est suivie par un régime tectonique compressif qui va entrainer la collision proprement dite entre la plaque ibérique et la plaque Eurasie, provoquant le début du soulèvement du massif et la formation des Pyrénées.
Sous l’effet de compression, la plaque ibérique commence à passer sous l’Eurasie. La phase d’orogenèse pyrénéenne débute ainsi au Paléocène, il y a environ 60 millions d’années. Le paroxysme de cette phase de collision est daté d’il y a 50 à 40 millions d’années.
L’orogénèse pyrénéenne est donc antérieure à l’orogenèse alpine, toutes deux se déroulant cependant à l’ère Tertiaire.
https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/geologie-sont-formees-pyrenees-16406/
Massif Central
Environ 100 millions d’années après le plissement hercynien (à environ -200 millions d’années), le massif central est en grande partie démantelé puis envahi par la Mer. Celle-ci y restera pendant 100 millions d’années jusqu’à la fin du Secondaire.
A partir de l’éocène (Tertiaire), il y a 30 à 40 millions d’années, la formation de la chaine Alpine provoque l’apparition de fractures qui découpent le massif central en plusieurs compartiments : bassins d’effondrement de Limagne, St Flour, Aurillac et Le Puy.
Puis dans les 15 derniers millions d’années, les premiers édifices volcaniques apparaissent dus en partie à l’amincissement de la lithosphère au niveau de ces fractures, ou provoquée par la descente de la plaque européenne sous la plaque africaine au niveau des Alpes.
Les volcanisme les plus récent est celui de la chaine des Puys qui date de l’ère Quaternaire (Pleistocène et Holocène)
Jura
De -250 à -100 millions d’années (Secondaire), le Jura était submergé par une mer peu profonde en bordure de l’océan Téthys qui occupait l’espace des Alpes actuelles. Ces conditions ont permis le dépôt de grande quantité de sédiments d’origine biologiques qui ont formé beaucoup de calcaire. Les roches qui forment le Jura ont donc été formées à l’ère Secondaire.
A l’ère Tertiaire, la surrection des Alpes a provoqué, par phénomène distant, le plissement du territoire jurassien.
Vosges
Au début du Secondaire, c’est sur une surface quasiment plane laissée par l’érosion de la chaine hercynienne que vont se déposer des sédiments continentaux, puis marins.Au Jurassique (-190 à -140 millions d’années) le Ballon d’Alsace est complètement recouvert par la mer.
C’est au cours du Tertiaire, durant l’histoire alpine, que les Vosges seront relevées et que l’érosion du revêtement sédimentaire portera leur socle cristallin à affleurement. Les reliefs actuels résultent de l’incision de cette surface par l’érosion récente, glaciaire notamment. Les formes arrondies qui en résultent ont longtemps fait croire à leur vieillesse… ils ont pourtant le même âge que les reliefs alpins !
Corse
A l’époque de la formation de la Pangée, la Corse fait partie du sud de la chaine hercynienne.
Au début du Tertiaire, la remontée vers le nord de la plaque africaine et de la plaque ibérique forme par compression la chaîne pyrénéo-provençale. La Corse et la Sardaigne en font partie.
Entre -35 et -18 millions d’années, le micro-continent formé par la Corse et la Sardaigne se détache du Sud de la France et acquiert son insularité.
Il ne faut pas oublier que depuis 2 millions d’années, la Terre alterne des périodes de glaciation et des épisodes interglaciaires. Ce sont ces épisodes, et particulièrement la dernière période glaciaire – ou glaciation de Würm – qui ont donné les reliefs que l’on peut observer aujourd’hui dans les différents massifs français.